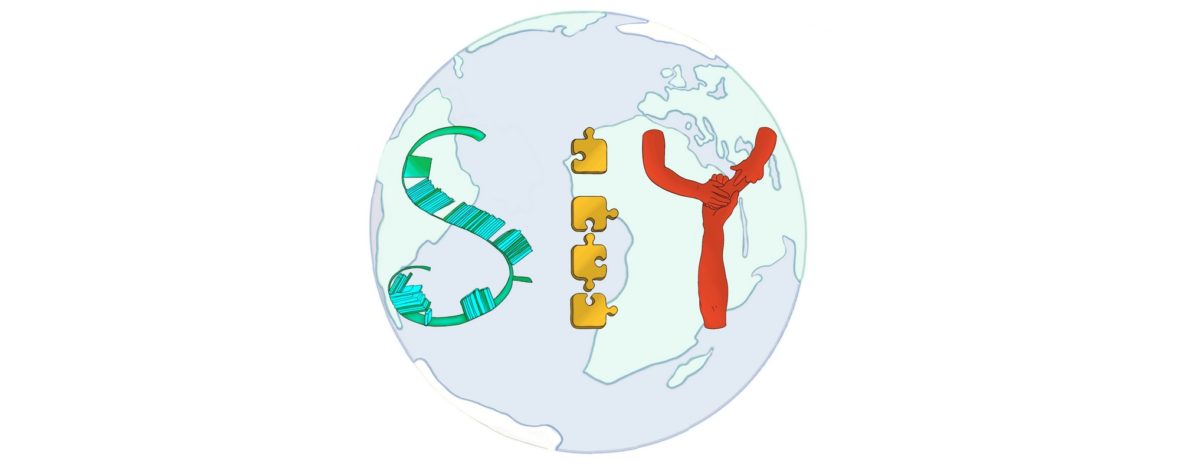Dans l’idéal, l’école devrait être un lieu où les parents peuvent jouer un rôle actif dans la vie scolaire de leurs enfants. En plus d’encourager leur présence lors des moments de transition, tels que le matin et le soir, il est bénéfique d’envisager des occasions spéciales où les parents peuvent passer une journée par semaine en activité avec la classe. Cette proximité offre aux enfants la présence rassurante de leurs figures d’attachement, renforce leur sécurité émotionnelle et favorise leur épanouissement émotionnel, social et académique. En encourageant la participation active des parents dans la vie scolaire, nous créons un environnement propice à la confiance, à la collaboration et au développement harmonieux de chaque enfant.
Renforcer la sécurité émotionnelle grâce à la présence parentale
Lorsque les parents sont présents à l’école, l’enfant se sent plus sécurisé, sachant que ses figures d’attachement sont à proximité. Cela lui procure un sentiment de confort et de confiance qui favorise son bien-être émotionnel. La présence des parents lors des moments de transition (environ 45 minutes, parfois plus, parfois moins), tels que le départ le matin ou la récupération à la fin de la journée, permet à l’enfant de se sentir soutenu et entouré, renforçant ainsi sa sécurité émotionnelle.
Lire la suite « Favoriser la présence parentale à l’école pour le bien-être de l’enfant »